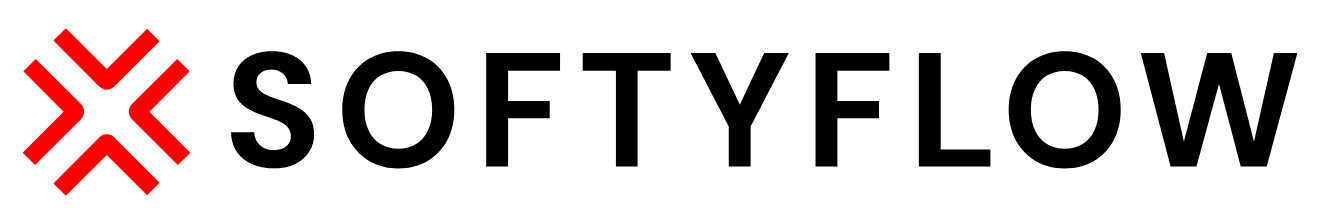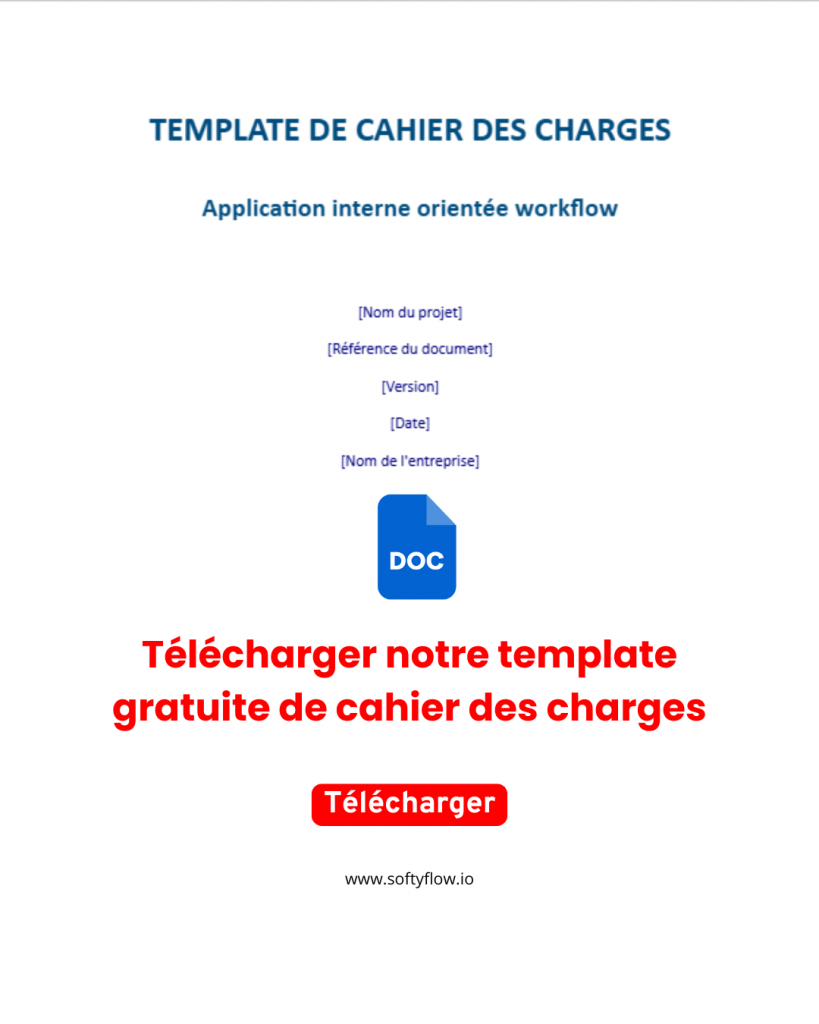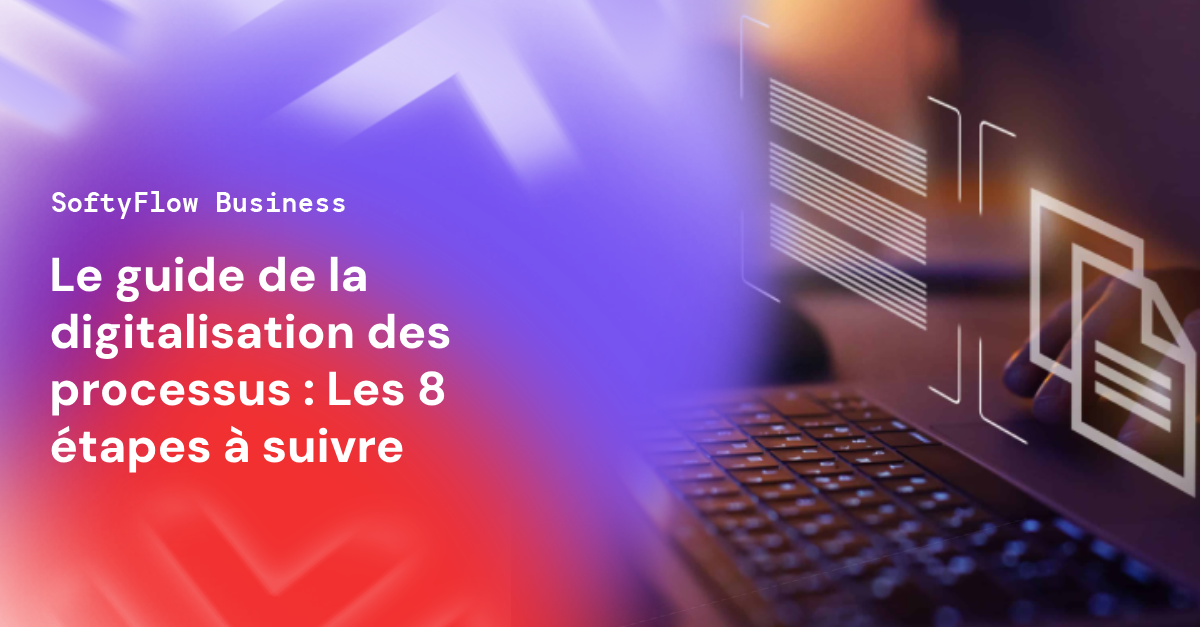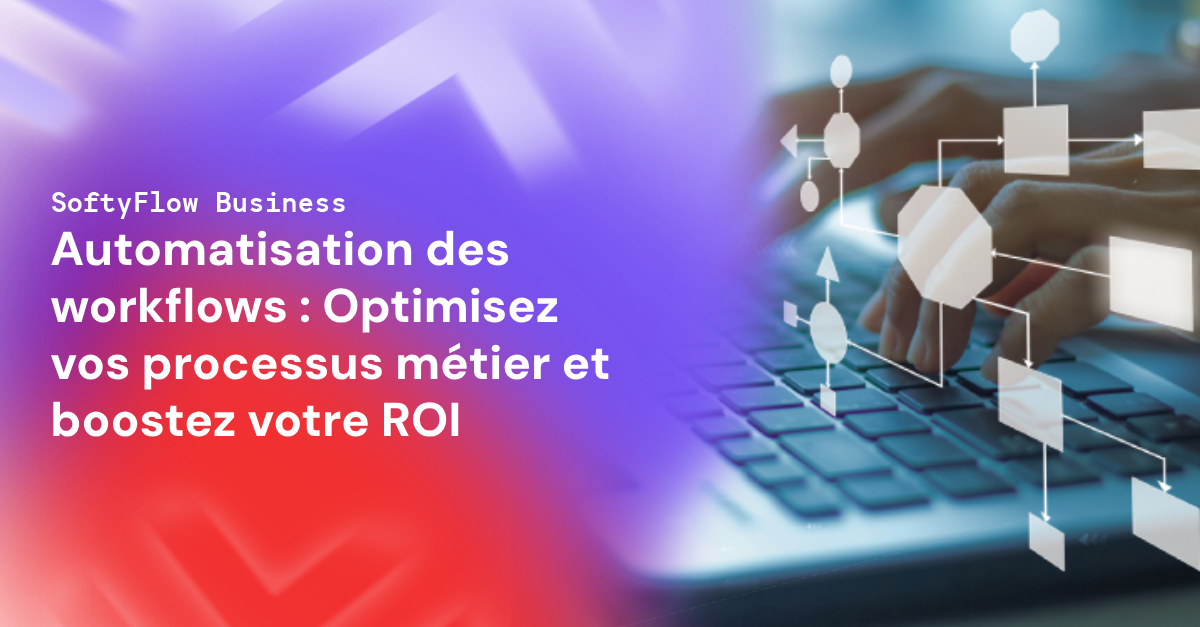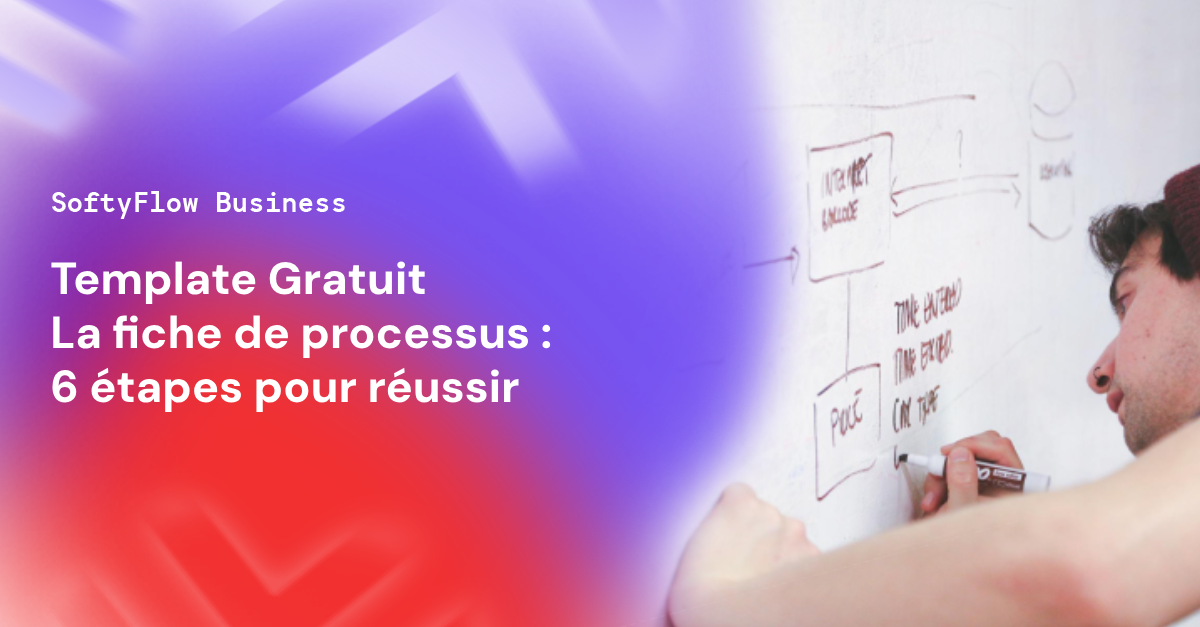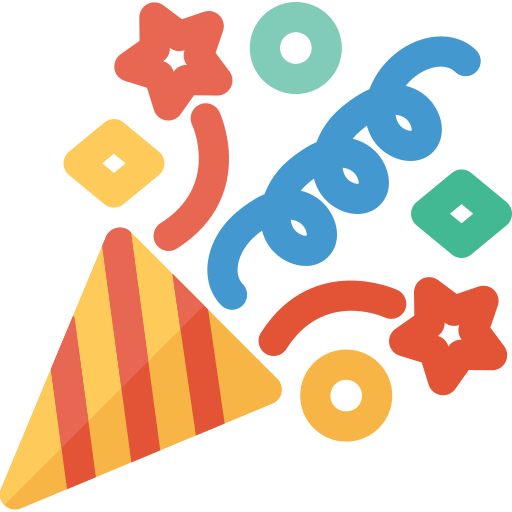Introduction
Dans tout projet – qu’il s’agisse de concevoir un nouveau produit ou service, de développer une application mobile, de mettre en place un service interne ou encore de faire évoluer un système existant –, la définition claire des besoins et des fonctionnalités attendues est un impératif pour garantir la réussite du projet. Pour cela, il existe un outil incontournable : le cahier des charges fonctionnel. Ce document détaillé sert de base à l’ensemble des acteurs impliqués, en constituant un cadre de réponse permettant de définir les besoins et d’expliciter, de manière précise et manière détaillée, les exigences fonctionnelles et les contraintes du produit ou du service à développer.
Dans cet article, nous allons présenter de manière exhaustive ce qu’est un cahier des charges fonctionnel, développer la manière de son élaboration et les objectifs, expliquer la différence entre un cahier des charges fonctionnel (CDCF) et un cahier des charges techniques (CDC), et indiquer comment l’utiliser et l’établir dans le cadre d’une gestion de projet. Nous verrons aussi quels sont les éléments clés, pourquoi il est essentiel de rédiger un cahier de ce type et quelles positives on peut en attendre, notamment en termes de retour sur investissement et de clarté pour le client et les prestataires. Enfin, nous prendrons l’exemple de la solution Softyflow, un outil de BPM (Business Process Management) dédié à la gestion et à l’automatisation de workflows, pour illustrer la nécessité et l’importance de concevoir un cahier des charges avant toute mise en place.
Notre objectif est de fournir un guide professionnel et pédagogique, suffisamment détaillé pour constituer une référence solide en matière de cahier des charges fonctionnel. Nous aborderons les étapes de rédaction, le plan et la structure type, ainsi que les critères d’évaluation à prendre en compte au début et durant tout le cycle de vie du projet. Nous évoquerons également la norme afnor, en particulier la norme NF en 16271, qui définit l’expression fonctionnelle du besoin, ainsi que des notions clés comme l’analyse fonctionnelle du besoin, l’analyse de la valeur ou encore le management par la valeur, afin de donner une vision globale et cohérente du sujet.
I. Qu’est-ce qu’un cahier des charges fonctionnel ?
Le cahier des charges fonctionnel – souvent abrégé en CDCF – est un document qui décrit, de façon la plus complète possible, les fonctions de service attendues d’un produit ou service, ainsi que les exigences et les contraintes associées. Autrement dit, le CDCF est un document qui se focalise davantage sur le « quoi » que sur le « comment ». Sa vocation est d’exprimer les besoin et cahier d’un client ou d’un utilisateur, indépendamment de la solution technique retenue pour y répondre.
Pour reprendre la terminologie consacrée, on considère que le cahier des charges fonctionnel doit décrire la fonction principale et les fonctions de service associées, ainsi que les critères d’acceptation. Il peut s’appliquer à un projet de création de produit, de service, ou de mise en place d’un système complexe. Il constitue en quelque sorte la présentation générale du problème à résoudre, en se basant sur l’analyse fonctionnelle, c’est-à-dire l’expression des besoins et leur hiérarchisation.

1. La logique du besoin
Comme son nom l’indique, le cahier des charges fonctionnel est centré sur la fonctionnelle attendue du produit ou le service. Il précise donc les exigences fonctionnelles et les fonctionnalités qui devront être respectées pour satisfaire le besoin du client ou de l’acteur demandeur. C’est la raison pour laquelle on parle souvent d’analyse fonctionnelle du besoin, puisqu’on part de la question : « De quoi a-t-on besoin ? » plutôt que « Comment allons-nous le réaliser ? ».
La norme NF en 16271 relative à la qualité et à l’expression fonctionnelle du besoin préconise une décomposition logique visant à isoler de manière rigoureuse les attendus réelles. Cela passe notamment par le recensement des besoins des utilisateurs, l’identification des services et de contraintes, la mise en évidence des différentes fonctions que devra remplir le produit ou service, ainsi que la définition des critères de performance et de coût ou encore les délais de réalisation.
2. « Fonctionnel » vs « technique »
Il est important de souligner que le cahier des charges fonctionnel (ou CDCF) ne cherche pas à définir les spécifications d’ordre purement technique. C’est pourquoi on l’oppose souvent au cahier des charges techniques (ou CDC). Le CDC est davantage focalisé sur la description précise du fonctionnement interne, sur les choix d’architecture, de composants matériels et logiciels, sur les protocoles de communication, les standards à respecter, etc. Le CDCF se situe en amont, se concentrant sur la finalité et la raison d’être du futur produit.
Cependant, dans la pratique, et particulièrement dans des projets complexes, il arrive que les deux cahiers – fonctionnel et technique – soient combinés ou fassent partie d’un même document plus large, afin de garantir une cohérence globale et une vision unifiée. Néanmoins, pour la réalisation du projet, on gagne souvent en efficacité en séparant ces deux approches : le cahier des charges fonctionnel est un référentiel pour l’expression des besoins, tandis que le CDC technique sera un référentiel pour la réponse en termes de solution et de faisabilité technologique.
Optimisez vos projet avec des cahiers de charges
II. Comment rédiger un cahier des charges fonctionnel ?
La question « Comment rédiger un cahier des charges fonctionnel ? » revient fréquemment. En effet, il ne suffit pas de lister quelques exigences fonctionnelles à la volée pour obtenir un document cohérent. Une véritable méthodologie et un plan type doivent être suivis pour garantir la qualité et l’exhaustivité du cahier. Le cahier des charges fonctionnel doit être structuré, compréhensible par tous, rédigé dans une manière détaillée et validé par l’ensemble des acteurs impliqués. Voici donc quelques étapes de rédaction incontournables.
1. Définir le périmètre et le contexte du projet
Avant de se lancer dans l’étude et la rédaction du cahier, il est impératif de clarifier le contexte du projet. Pourquoi met-on ce projet en place ? Quel est l’environnement, quelles sont les raisons qui motivent sa mise en œuvre ? Quels sont les enjeux et les objectifs visés ? Cela peut inclure :
- Une présentation générale du problème à résoudre, éventuellement l’historique et la situation actuelle.
- Les besoins exprimés par le client, le centre de formation, ou le service interne concerné.
- Les contraintes externes ou internes (budget, délai, contraintes légales, etc.).
C’est également dans cette partie que l’on définit le cadre de réponse : les acteurs qui participent au projet, leurs rôles, leurs attentes, ainsi que la gestion de projet globale (organisation, comité de pilotage, etc.).
2. Recueillir et formaliser l’expression des besoins
La phase de recueil des besoins est cruciale. Ici, on mobilise des techniques d’analyse comme les entretiens, les questionnaires, l’étude de faisabilité, les observations de terrain, ou encore la documentation existante. Une fois les besoins identifiés, on procède à leur formalisation dans un langage clair et non ambigu. On parle souvent d’analyse fonctionnelle (ou analyse fonctionnelle du besoin) pour décomposer ces besoins en fonctions (essentielles, secondaires, etc.) et préciser les critères de réussite.
Par exemple, si l’on souhaite créer un logiciel pour gérer un centre de formation, on définira les fonctions attendues : inscription des apprenants, planification des sessions, suivi du début de la formation jusqu’à la fin, facturation, etc. Chaque fonction doit être décrite avec précision, en identifiant le niveau de priorité et les exigences fonctionnelles attendues.
3. Rédiger et structurer le cahier
Une fois l’expression des besoins clairement définie, on passe à la rédaction du cahier Il s’agit d’établir le cahier ou, comme on dit souvent, de rédiger un cahier. Même s’il n’existe pas de format universel, on retrouve généralement un modèle de cahier proche du plan type suivant :
- Introduction et objet du document
– Contexte du projet
– Objectifs du projet
– Périmètre fonctionnel - Description fonctionnelle
– Présentation générale du problème et analyse fonctionnelle
– Liste des fonctions de service (avec fonction principale et fonctions secondaires)
– Exigences fonctionnelles et contraintes associées
– Critères de performance, de fiabilité, de disponibilité, etc. - Environnement du produit
– Environnement du produit ou du service (technique, organisationnel, humain)
– Interfaces éventuelles avec d’autres systèmes
– Personnes et services prenantes - Modalités de mise en œuvre
– Mise en œuvre du projet : planning, planification, étapes clés
– Gestion de projet : responsabilités, communication, suivi, évaluation
– Cadre de réponse : ce qu’on attend d’un fournisseur ou d’un prestataire éventuel - Critères d’acceptation et de validation
– Indicateurs, critères de test, modalités d’évaluation
– Mesure de la conformité aux exigences fonctionnelles
– Processus de validation et d’approbation - Annexes
– Documents complémentaires (ex. : étude technique, maquettes, diagramme UML, etc.)
– Glossaire, référence afnor, norme de conception, etc.
Cette structure type, suffisamment simple et claire, peut être adaptée en fonction du projet. Elle constitue néanmoins un socle solide pour présenter l’expression fonctionnelle du besoin. Il est également fréquent de proposer un format PDF, éventuellement un espace collaboratif en ligne, pour faciliter la réponse des parties externes et le partage d’informations.
4. Valider le cahier des charges fonctionnel
Une fois le cahier des charges fonctionnel rédigé, il doit être validé par l’ensemble des acteurs impliqués, au premier rang desquels le client ou le chef de projet. Cette validation peut donner lieu à des itérations, des évalués sur la base de prototypes ou encore des maquettes, afin de s’assurer que tous les besoins ont été pris en compte et que le cahier est bien réaliste. C’est une étape cruciale pour éviter tout malentendu et tout risque de dérive ultérieure.
Rédigez vos cahiers de charges
III. Quels sont les objectifs d’un cahier des charges ?

Le cahier des charges – et plus particulièrement le cahier des charges fonctionnel – poursuit plusieurs objectifs fondamentaux dans un projet. On peut notamment citer :
- Définir les besoins et les fonctionnalités attendues : il s’agit de recenser de façon exhaustive tout ce qui est demandé par les utilisateurs ou le client, afin de disposer d’une base partagée.
- Fournir un cadre de réponse : le cahier des charges sert de référence pour toute proposition de solution. Les intervenants, internes ou externes, savent précisément quels résultats livrer.
- Servir de base à la conception et à la mise en œuvre : en décrivant clairement les exigences fonctionnelles et en relevant les parties techniques, on donne aux concepteurs ou au service de développement toutes les informations nécessaires pour créer une solution adaptée.
- Faciliter la planification et la gestion du projet : en listant les priorités, les choix techniques, le cycle de vie du projet, les contraintes, etc., on balise la mise en placeca et le suivi du projet.
- Assurer la communication et la validation : le cahier des charges constitue un objet de négociation et de consensus, garantissant que tous les acteurs partagent la même vision. Il est la clé d’une bonne collaboration.
- Minimiser les risques d’erreur ou de dérive : en fixant dès le départ les fonctionnalités attendues et les critères d’évaluation, on évite les incompréhensions et on réduit les risques de dépassement de coût ou de délai.
- Garantir la réussite du projet : un cahier bien conçu est un gage de clarité, de communication fluide, et donc d’une meilleure réalisation et d’un retour sur investissement optimisé.
IV. Quelle est la différence entre CDCF et CDC ?
La différence entre le cahier des charges fonctionnel (CDCF) et le cahier des charges techniques (CDC) est centrale pour bien comprendre la finalité d’un projet. Souvent, on résume cette différence de la façon suivante :
- Le CDCF décrit ce qu’il faut faire (du point de vue fonctionnel, donc analyse du besoin, expression de la fonctionnalité, objectifs et critères de validation).
- Le CDC décrit comment on va le faire (du point de vue technique, matériel, logiciel, spécifications de développement, etc.).
En d’autres termes, le cahier des charges fonctionnel s’adresse d’abord aux acteurs métier, aux utilisateurs, au client, pour qu’ils puissent exprimer clairement leurs attentes et comprendre quelles sont les fonctions apportées par la future solution. Le cahier des charges techniques, quant à lui, est plutôt à destination des équipes techniques, des ingénieurs, des développeurs ou des architectes, qui vont concevoir et construire la solution.
Dans certains projets de grande envergure, on trouve ainsi un CDCF et un CDC distincts. Dans d’autres cas, on fusionne ces deux documents dans un seul cahier plus complet, parfois appelé CDCF/CDCt, pour éviter les doublons. L’important est de garder clairement en tête la distinction fonctionnel vs technique, afin de ne pas mélanger la fonction (le « pourquoi ») et la partie technique (le « comment ») dans le même bloc d’information.
V. Comment utiliser un cahier des charges dans un projet ?
Le cahier des charges s’intègre dans le cycle de vie du projet. Son rôle est essentiel lors de la planification, mais il reste tout aussi important lors du suivi et de l’évaluation du projet.
- Planification : une fois le cahier des charges fonctionnel finalisé, il sert de référence pour estimer le budget, évaluer les ressources nécessaires et préparer un planning réaliste. En se basant sur les exigences fonctionnelles, on peut découper le projet en étapes de travail, définir des jalons, etc.
- Mise en œuvre : pendant la phase de réalisation, le cahier est consulté régulièrement pour s’assurer que la solution développée correspond bien aux besoins décrits. Il est un outil de gestion de projet et permet de suivre l’évolution du projet en fonction des critères définis.
- Suivi et évaluation : à l’issue de chaque itération ou livraison intermédiaire, on compare le résultat avec les exigences formulées dans le cahier. Cela permet une évaluation continue et évite de s’apercevoir trop tard d’un écart majeur.
- Validation et livraison : au final, le cahier des charges fonctionnel sert également à valider que la solution répond à l’ensemble des fonctionnalités attendues et respecte les critères. C’est un outil de communication qui facilite la validation finale par le client ou par les personnes chargées d’homologuer la solution.
Dans certains cas, notamment pour des projets complexes ou de longue durée, le cahier peut être révisé en cours de route. Les besoins peuvent évoluer, ou certaines contraintes se révéler inadaptées. Toutefois, ces modifications doivent être documentées et validées pour conserver une maîtrise du projet.
VI. Quels sont les éléments d’un cahier des charges fonctionnel ?
Le cahier des charges fonctionnel comprend plusieurs éléments clés que l’on retrouve souvent sous forme d’un plan type ou d’un modèle de cahier. Nous les avons déjà évoqués, mais les principaux éléments sont :
- Description fonctionnelle et analyse fonctionnelle : c’est le cœur du cahier. On y décrit les fonctions que doit assurer la future solution, les fonctionnalités attendues, les exigences fonctionnelles et la fonction principale du produit ou le service.
- Partie technique (limité dans le cadre d’un cahier des charges fonctionnel) : on y évoque les contraintes majeures, voire les interfaces, mais sans s’étendre sur la solution technique finale qui fera l’objet du CDC technique.
- Environnement du produit : on décrit l’environnement dans lequel le produit devra évoluer, les services ou systèmes avec lesquels il sera en interaction, etc.
- Critères de performance, de qualité, de fiabilité, etc., qui permettront de valider la conformité du produit aux besoins.
- Cadre de réponse et modalité de mise en œuvre : comment un prestataire ou un service interne devra structurer son offre pour répondre au cahier.
- Planification et gestion du projet : jalons, responsables, étapes de rédaction.
- Outils ou méthodes de suivi et d’évaluation : indicateurs, check-lists, etc.
L’analyse fonctionnelle et la description fonctionnelle sont souvent considérées comme le noyau dur, puisqu’elles expriment la finalité et les besoins opérationnels. Vient ensuite la partie technique sommaire (on ne parle pas encore de la conception détaillée), mais qui sert à souligner certaines contraintes majeures (par exemple, obligation d’utiliser tel système d’exploitation ou tel standard d’échange de données). On doit également prévoir des critères pour juger si la solution proposée répond bien aux exigences : on parle alors d’indicateurs de performance ou de critères d’évaluation.
Démarrez avec Softyflow, la solution low code
VII. Pourquoi est-il important de rédiger un cahier des charges ?
Nombreux sont les acteurs qui se demandent parfois pourquoi ils devraient perdre du temps à rédiger un cahier des charges avant de se lancer dans le développement ou la conception. Or, l’importance d’un tel document est cruciale pour plusieurs raisons :
- Communication et clarté : le cahier assure une compréhension commune du projet entre tous les intervenants. Il constitue un référentiel unique pour définir les fonctionnalités attendues, éviter les malentendus, limiter les quiproquos et, in fine, gagner en efficacité.
- Validation des besoins : en formalisant les attentes, on obtient une validation explicite du client ou de l’utilisateur final. Cela évite que, plus tard, des fonctionnalités manquent ou soient mal comprises.
- Planification plus fiable : avec un cahier des charges fonctionnel précis, il est plus aisé d’estimer les ressources, le temps, les compétences nécessaires, et de planifier efficacement les différentes étapes.
- Réduction des coûts et des risques : en détectant dès le départ d’éventuelles incohérences, on limite les modifications tardives, souvent coûteuses. Cela permet également de limiter les retards de livraison.
- Amélioration du retour sur investissement : investir du temps dans un cahier structuré et complet en début de projet est un gage de réussite du projet. La solution livrée sera plus en adéquation avec les besoins, ce qui accroît la valeur générée et la satisfaction des utilisateurs.
- Outil de maîtrise : c’est un outil de management et de maîtrise du projet qui facilite la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation continue.
- Justification et traçabilité : en cas de litige ou de questionnement sur la finalité d’une fonctionnalité, on peut toujours se référer au cahier pour justifier les choix effectués ou rediscuter les points litigieux.
En somme, le cahier des charges fonctionnel est un ouvrage essentiel pour définir les objectifs, consolider l’expression fonctionnelle du besoin, encadrer la réalisation technique et garantir la réussite du projet dans son ensemble.
Télécharger la template de cahier des charges
VIII. Exemple pratique : le cas de Softyflow, un outil de BPM et de gestion de workflow
Pour illustrer l’importance et la pratique de la rédaction du cahier, prenons l’exemple de Softyflow, une solution de BPM (Business Process Management) spécialisée dans l’automatisation des workflow d’entreprise. Imaginons que vous souhaitiez intégrer Softyflow au sein de votre organisation pour fluidifier vos processus administratifs, diminuer les ressaisies inutiles et améliorer la traçabilité des opérations.
- Contexte et périmètre
– Vous dirigez un centre de formation et souhaitez mettre en place un outil centralisé pour gérer les inscriptions, les plannings et le suivi financier.
– Vous avez plusieurs services impliqués : service commercial, service pédagogique, service comptabilité, etc.
– Vous avez identifié que Softyflow propose des fonctionnalités de workflow adaptables à chaque service. - Analyse fonctionnelle du besoin
– Vous commencez par l’expression fonctionnelle du besoin : quels sont exactement les besoins de vos équipes ? Quelles fonctionnalités attendues ?
– Par exemple : un service doit répondre à la demande d’un formateur qui souhaite programmer une session. Cela implique la réservation d’une salle, la vérification des disponibilités, la communication aux apprenants.
– Vous listez ensuite les contraintes (compatibilité avec votre SI existant, respect de la confidentialité des données, respect de la norme RGPD, etc.). - Description fonctionnelle
– Vous rédigez une description fonctionnelle précise : les fonctions de service que Softyflow devra remplir (gestion d’un workflow d’approbation, notification automatique, génération de rapports, etc.).
– Vous précisez la fonction principale : automatiser les processus administratifs et pédagogiques.
– Vous identifiez les critères de réussite : temps de traitement réduit, diminution des erreurs de saisie, satisfaction des utilisateurs. - Partie technique (sommaire)
– Vous indiquez dans quelle environnement (Windows Server, Linux, Cloud, etc.) le logiciel devra s’installer.
– Vous précisez les grandes lignes de la mise en œuvre : un déploiement progressif, une phase de test sur un groupe pilote, etc.
– Les détails plus poussés (choix de la base de données, architecture logicielle) relèveront du cahier des charges techniques. - Mise en place et gestion du projet
– Vous planifiez la mise en place de Softyflow sur trois mois, avec un lancement du projet début mai, une phase pilote en juin, et un déploiement final en juillet.
– Vous définissez un comité de pilotage composé de représentants de chaque service impacté.
– Vous prévoyez des points réguliers de suivi et une évaluation des résultats. - Validation et conclusion
– Le cahier des charges fonctionnel finalisé (votre CDCF est un document écrit) est validé par l’ensemble des acteurs (direction, responsables de service, équipe IT, etc.).
– Vous lancez un appel à Softyflow (ou à un prestataire certifié) pour qu’ils s’engagent sur la livraison de la solution, le coût et le respect des exigences.
– Vous démarrez le projet en ayant un référentiel clair pour évaluer l’avancement et la performance de Softyflow au regard de vos besoins initiaux.
Ce exemple démontre que, pour un outil de BPM comme Softyflow, la mise en place d’un cahier des charges fonctionnel est le point de départ incontournable. Il formalise vos besoins, encadre la solution envisagée et garantit que le projet sera mené dans de bonnes conditions.
IX. Conclusion
Le cahier des charges fonctionnel est un pilier de tout projet réussi. Il constitue le pont essentiel entre l’expression fonctionnelle du besoin et la réalisation du projet en termes de solution concrète. Grâce à une analyse fonctionnelle rigoureuse, à une méthodologie de rédaction structurée et à une validation minutieuse de l’ensemble des acteurs, il permet de poser des bases solides pour éviter les incompréhensions, maîtriser les contraintes et s’assurer que les fonctionnalités attendues seront effectivement livrées.
Nous avons vu en quoi ce document – le CDCF – se distingue du cahier des charges techniques (CDC), qui lui est plus centré sur les aspects de conception et de spécifications technologiques. Nous avons également rappelé les objectifs du projet que sert le cahier des charges fonctionnel : définir les besoins en début de projet, fournir un cadre de réponse aux équipes de conception ou aux prestataires, guider la mise en œuvre et la gestion de projet au fil du cycle de vie, et assurer une évaluation continue et finale, gage d’une réussite du projet et d’un bon retour sur investissement.
La différence fondamentale entre CDCF et CDC tient donc à la nature même de la fonction par rapport à la partie technique. Le premier s’attache à la fonctionnalité et à l’expression des besoins, tandis que le second s’attache à la « recette technique » pour répondre à ces besoins. Leur complémentarité est indispensable.
Enfin, nous avons illustré l’importance de rédiger un cahier des charges avec l’exemple de Softyflow, un outil de BPM et de workflow qui, comme la plupart des systèmes d’information, nécessite en amont un cahier parfaitement renseigné pour répondre aux besoins métiers. L’adoption de Softyflow dans un centre de formation ou toute autre entreprise doit se fonder sur une étude précise, une analyse de la situation et une formulation d’exigences et de critères clairement exposés, afin de garantir la viabilité du projet et la satisfaction du client final.
En conclusion, établir un cahier des charges fonctionnel n’est pas une tâche superflue ni bureaucratique. C’est au contraire une condition sine qua non pour encadrer la mise en place, assurer la bonne communication, fixer les critères de succès et conserver une maîtrise globale du projet tout au long de son cycle de vie. Toute organisation, quelle que soit sa taille ou son domaine d’activité, gagnerait à inclure systématiquement cette approche dans sa démarche de développement ou de transformation, qu’elle s’adresse à un service interne ou à un fournisseur externe. C’est la meilleure garantie de voir aboutir un projet dans les délais, au coût fixé, et avec toutes les fonctionnalités attendues, contribuant ainsi à la réussite du projet et à la satisfaction de l’ensemble des acteurs impliqués.